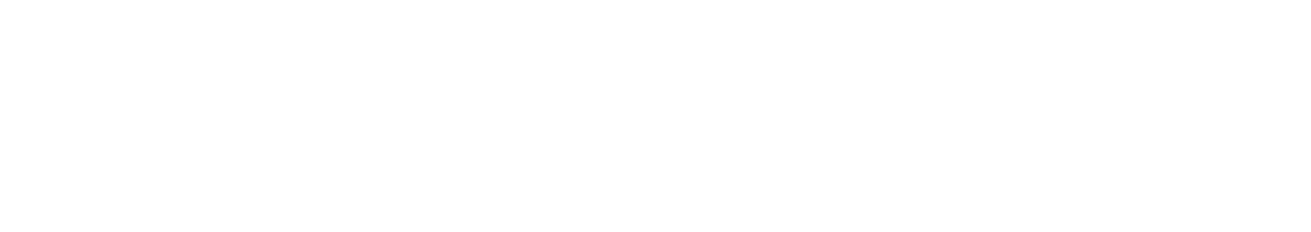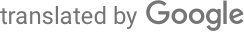Rana Awdish, docteure en médecine, est médecin en soins intensifs à l'hôpital Henry Ford de Détroit. Dans un article du New England Journal of Medicine qui a été consulté plus de 100 000 fois, elle a décrit avec franchise comment sa propre expérience de mort imminente a changé sa façon de penser la médecine. IHI s'est récemment entretenue avec elle sur le pouvoir de la narration et sur la façon dont l'empathie peut prévenir l'épuisement professionnel. Le Dr Awdish était l'une des principales conférencières du Forum national 2017 de IHI .
Qu’est-ce qui vous a poussé à décrire publiquement votre expérience de patiente ? Était-ce une décision difficile à prendre ?
J’ai réalisé qu’en tant que médecin dans ma propre institution, j’étais, du moins en théorie, une minorité habilitée. J’étais quelqu’un qui avait une voix, une certaine autorité et une certaine capacité d’action personnelle. Pourtant, en tant que patient, je ne me sentais pas du tout habilité à exprimer mes besoins ou mes craintes. J’ai pensé à la façon dont on devient sans voix à bien des égards simplement à cause de la maladie. Et, peut-être plus important encore, j’ai réalisé que, si je ressentais cela, alors cette expérience était beaucoup plus courante que je ne l’avais cru.
Une fois que j'ai compris les choses ainsi, je me suis sentie obligée d'admettre que mon propre système m'avait laissé tomber à bien des égards, car s'il me laissait tomber, il allait forcément laisser tomber les autres. Qu'en est-il des personnes qui ne possèdent pas le vocabulaire médical ou les connaissances de base sur ce qui se passe dans leur corps ? Qu'en est-il de celles qui ne connaissent pas les personnes présentes dans la salle ou le rôle qu'elles sont censées jouer ? La médecine est une boîte noire pour beaucoup.
Nous avons l'obligation de régler ce problème pour les personnes qui ne peuvent pas nous le dire. Une fois que j'ai ressenti cette responsabilité, cela m'a conduit à écrire cet article et, finalement, à écrire un livre sur mon expérience.
Dans l’article du NEJM , vous avez admis avoir fait et dit le genre de choses que vous trouviez douloureuses en tant que patient.
Il était vraiment important pour moi de raconter cette histoire, sans chercher à attribuer des fautes ou à pointer du doigt quelqu’un. Il s’agissait de décrire notre culture. C’est ce que nous sommes, ce que j’étais. Je n’avais simplement pas vu les choses du point de vue du patient. Tant que vous ne faites pas cela, vous ne pouvez pas vraiment apprécier l’importance des plus petites choses – les choses que nous disons avec désinvolture, celles que nous pensons ne pas entendre, la façon désinvolte dont nous présentons la maladie aux gens – tout cela compte. C’est ancré dans les métaphores de la maladie que nous utilisons – la maladie comme une bataille, une guerre. Il y a tellement de choses inconscientes et qui font partie de la culture que nous devons, selon moi, faire remonter à la surface pour pouvoir dire : « Voilà qui nous sommes. Est-ce ce que nous voulons être ? Parce qu’à cet instant précis, c’est ce que nous sommes. »
Grâce à votre expérience, les nouveaux employés de votre organisation apprennent désormais la différence entre la souffrance inévitable et la souffrance évitable. Pouvez-vous partager une histoire qui illustre l’importance de cette notion ?
La maladie est synonyme de souffrance. C'est une réalité incontournable. La maladie perturbe notre perception de qui nous sommes, de notre identité. Quand j'étais malade, j'ai trouvé remarquable qu'il y ait des gens qui savaient reconnaître la souffrance supplémentaire potentielle de certaines actions et qui prenaient des mesures pour l'atténuer.
Les situations qui m'ont le plus marqué sont celles des techniciens en radiologie, qui ont compris qu'ils pouvaient simplement couvrir mon mari, qui dormait à côté de moi, d'un tablier plombé au lieu de le réveiller tous les matins, alors qu'il n'avait pas dormi de la nuit. Cette souffrance était évitable. Il leur suffisait de le voir pour l'empêcher. Il y avait aussi des transporteurs qui ont alerté les techniciens en radiologie sur le fait que, même si mon dossier comportait un bracelet pour bébé, le bébé était mort et qu'ils ne devaient donc pas me poser de questions à son sujet.
Si l’un ou l’autre de ces groupes de personnes n’avait pensé qu’à leur rôle dans mes soins – faire la radiographie, me transporter du point A au point B – ils n’auraient pas vu mes besoins en tant que personne. Ils n’auraient pas vu comment ils pouvaient réduire la part évitable de ma souffrance.
Tous ceux qui travaillent dans le secteur de la santé ont des points de contact avec les patients. Il ne s'agit peut-être pas de points de contact cliniques, mais de points de contact importants.
Après cette première grossesse désastreuse, je suis tombée enceinte à nouveau. J’ai eu un fils qui a passé plusieurs semaines aux soins intensifs néonatals parce qu’il était né très prématurément. Je me souviens que le préposé au stationnement me regardait chaque matin lorsque je venais lui rendre visite. Un jour, le préposé au stationnement m’a dit : « Je te vois ici tous les jours et tu ne pars pas avant la fin de mon service. J’espère vraiment que la personne à qui tu rends visite s’en sortira bien. »
Il ne savait rien de plus sur moi que ce qu'il observait. Et pourtant, il a su faire preuve d'empathie et me réconforter. Il m'a fait savoir qu'il voyait ma souffrance. Ce simple fait d'être témoin peut être très puissant. Dans le domaine de la santé, notre lieu de travail devient normal pour nous. Nous ne réalisons pas que pour beaucoup de personnes qui franchissent nos portes ou se garent dans ce garage, ce sera peut-être la pire journée de leur vie. Nous avons tous le potentiel d'être ce point de contact qui illumine la journée de nos patients et qui reconnaît que ce n'est probablement pas là où vous voulez être à ce moment-là, mais nous vous voyons.
Votre article dans le New England Journal of Medicine a été très apprécié. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris dans la réaction de la population ?
J’étais mal à l’aise à l’idée de révéler nos échecs. Historiquement et culturellement, je pense que la médecine se considère à bien des égards comme une famille. On nous apprend à discuter de certaines choses au sein de notre famille, mais pas avec des personnes extérieures à la famille. On se protège les uns les autres. On fait bonne figure face aux personnes extérieures. Je me sentais coupable de raconter mon histoire. Cela me semblait un peu subversif. Mais je savais que nous devions examiner attentivement les moments où nous nous écartions des normes que nous nous étions fixées si nous voulions nous améliorer.
Ce qui m’a surpris, c’est la façon dont les gens ont accueilli l’article. Il a trouvé un terrain d’entente et cela m’a donné beaucoup d’espoir quant au fait que notre culture est en train de changer, que nous sommes prêts à être plus honnêtes et transparents, ce à quoi je ne croyais peut-être pas auparavant. Tous ceux qui ont accueilli l’article m’ont montré que nous sommes prêts à être différents. Nous sommes prêts à regarder nos échecs et à en parler honnêtement parce que nous voulons vraiment changer.
Qu’avez-vous appris sur l’importance de partager des histoires personnelles pour accélérer un changement significatif ?
C'est drôle parce que d'une certaine manière, j'ai toujours compris la valeur des histoires. Le premier contact que je me souviens avoir eu avec la médecine remonte à mon enfance. Mon petit frère, alors qu'il était bébé, a commencé à baver abondamment. Il souffrait d'épiglottite et ses voies respiratoires se fermaient. Ma mère a appelé le pédiatre et lui a décrit les symptômes au téléphone. « Il se penche en avant sur sa main. Il bave. Il fait un bruit horrible quand il respire. » Et le pédiatre a immédiatement reconnu ce dont il s'agissait et lui a donné des instructions sur la façon de le maintenir en vie pendant qu'ils se rendaient aux urgences.
Je me souviens avoir pensé que c’était la plus belle description de poste que je pouvais imaginer : écouter attentivement, et en écoutant, on pourrait guérir. À partir de ce moment-là, j’ai voulu devenir médecin.
Quelque part au cours de notre formation, nous perdons cet amour des histoires, car historiquement, en tant que médecins, la faculté de médecine nous apprend à écouter les histoires d'une manière très spécifique. Elle nous apprend à extraire ce qui est pertinent, puis à l'inscrire dans le contexte de la maladie, en laissant de côté toute la belle trame de l'histoire elle-même.
Ce que je trouve remarquable en ce moment, c'est que le secteur de la santé réexamine les histoires avec un regard beaucoup plus ouvert et généreux. Nous examinons la manière dont les histoires sont racontées et nous écoutons pourquoi elles sont racontées. Nous semblons reconnaître ce que les histoires peuvent nous dire sur nous-mêmes, sur les autres et sur ce que nous espérons devenir.
De nombreuses personnes ont des histoires sur ce qui les a amenées à se tourner vers les soins de santé. Nous pouvons utiliser ces histoires comme vecteurs de changement. Nous pouvons les utiliser pour examiner qui nous sommes, qui nous ne sommes pas et qui nous voulons être. Cela rend tout personnel et réel. C'est le meilleur outil dont nous disposons.
Dans quelle mesure la nécessité de se concentrer sur les données et les preuves contribue-t-elle à dévaloriser l’importance des histoires ?
Tous les médecins vous diront que le conflit de mission est un compagnon constant dans leur journée. Nous devons être efficaces. Nous devons nous concentrer sur les informations pour trouver le bon diagnostic, nous tenir au courant et suivre les directives de traitement fondées sur des données probantes.
Les médecins ne disent pas que nous sommes les seuls à pouvoir préserver l’âme et le caractère sacré de l’histoire patient-médecin. Toutes les forces qui nous entourent la démantèleront – si nous le leur permettons – parce que c’est la chose la plus efficace à faire. Mais il nous incombe de rester dans cet espace et de ne pas laisser ces pressions extérieures nous en éloigner, car c’est là que se trouve la longévité. C’est là que se trouve le sens. C’est là que se trouve la résilience.
Pensez-vous que le fait de ne plus établir de relations avec les patients contribue en partie à ce qui semble être une épidémie d’épuisement professionnel ?
Oui, je le pense. Si vous avez des contraintes de temps, vous en êtes redevable et il est facile de laisser tomber les choses que vous aimez. Je pense que les systèmes et les organisations peuvent aider en reconnaissant qu'une grande partie de ce qu'ils essaient d'accomplir en termes d'engagement des patients, d'activation des patients et de résilience des médecins, ils peuvent y parvenir en laissant de l'espace pour que ces relations se développent. Car s'ils perdent du temps pour établir des relations, ils ne peuvent rien faire d'autre, car nous ne saurons jamais qui sont nos patients en tant que personnes. Nous ne pourrons jamais établir de confiance. Nous n'aurons jamais le temps de leur permettre de nous révéler des aspects importants de leur vie et de leur personnalité. Nous n'obtiendrons pas les résultats de qualité liés à la santé que nous espérons obtenir, car les patients n'adhéreront pas au plan de traitement parce qu'ils ne l'auront pas co-créé avec nous.
Je pense que parfois, nous sommes nos pires ennemis. Nous essayons de tout systématiser alors que c'est la solution humaine qui est nécessaire.
Remarque : cette interview a été modifiée pour des raisons de longueur et de clarté.
Vous pourriez également être intéressé par :
- New England Journal of Medicine : « Un point de vue extérieur — Créer une culture de l’entraide »
- Suivez le Dr Awdish sur Twitter@RanaAwdish .